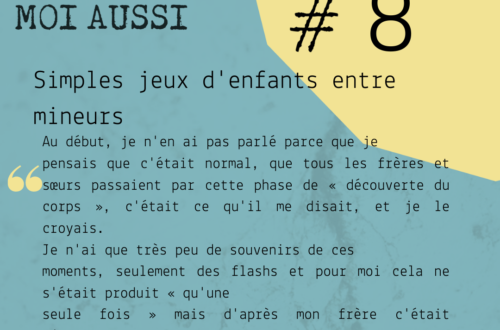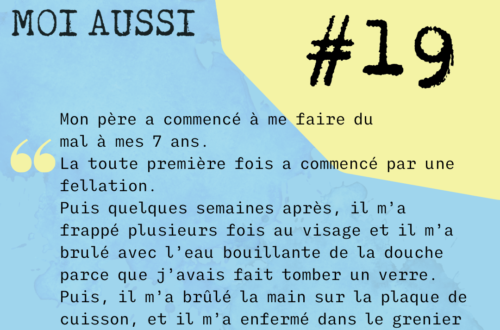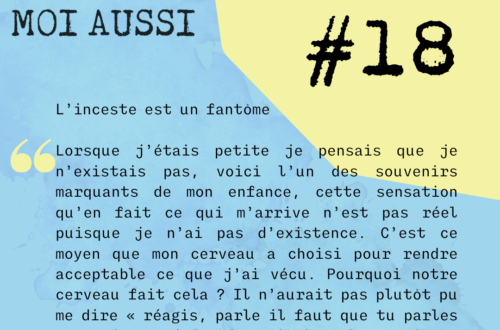Témoignage #2
TW : description explicite
C’est un de ces dimanches où l’on suffoque. On manque d’oxygène. Mais cette sensation d’être à bout de souffle est agréable parce qu’elle rime avec la chaleur de l’été, les fenêtre ouvertes, le rappel de ces journées de l’enfance chez ses grands-parents, les tours à vélo quand on vivait à la campagne, les après-midi à pagayer sur la Saône. C’est un temps chargé de la douce mélancolie de l’enfance, de ces souvenirs sucrés, acidulés et tellement agréables. J’ai les yeux fermés.
Ce dimanche, je sens la chaleur. Je me perds dans ces moments heureux. J’essaie de peindre le réel du beau des temps déjà évanouis. Il est tellement doux de me rappeler de ces instants où j’étais toute petite sur les genoux de pépé Erwin sur la tondeuse tracteur, à couper l’herbe de son champs et de celui de sa fille. C’est le sourire de la plénitude garanti. L’illusion peut durer un temps. C’est un moment de joie pure. Qu’est-ce que j’étais bien ces jours-là, sûre de l’aider du haut de mes trois pommes. Surement inutile, voir un frein pour lui dans cette tonte de l’herbe. Mais lui, jamais il ne me l’a fait sentir. Il était toujours tout sourire avec moi. Encore aujourd’hui, je me perdrais sans fin dans ces souvenirs. C’est mon escape room mental rien qu’à moi. Une parmi d’autres à vrai dire. Pépé Erwin a nourri mon enfance de joie. Un jardinier de l’amour et de l’enfance.
C’est une illusion que ce prisme des souvenirs doux à l’exactitude lugubre. Une illusion sensorielle aussi. J’invite tellement mes souvenirs que je pourrais presque sentir l’herbe fraîche. Je ressens encore l’effet de cette odeur sur moi.
J’essaie, ce dimanche-là, comme toujours, d’arnaquer mon cerveau. L’air est en réalité vicié, chargé de l’angoisse, de la peur, de l’appréhension, du dégout, de la nausée. Je m’accroche dans cette anémie ventilatoire, à ce rappel du passé qui s’échappe du présent. L’éther de ce qui n’est plus. Je n’y arrive plus. Je suis pourtant la marathonienne de la mémoire, mais tout s’évapore de moi. Ils m’échappent, je crie en moi « revenez ». Oui, revenez ces temps magiques où la joie prenait toute la place et que la terreur n’était qu’une petite boite enfouie sous terre.
Une larme coule sur ma joue gauche. Elle raconte tout ce qui ne se dit pas. Tout ce que ce silence porte de mots qui ne sont pas encore présents. Je suis triste de ses images fugaces si lointaines. Je les veux. Je les supplie de revenir dans mon présent, ne plus être un bout du passé. Je voudrais m’y enfermer pour toujours. Et puis, je cherche obstinément une image dans ma tête. Mais le vide se fait. Il n’y plus rien dans mon projecteur interne. C’est la vacuité d’une tête vide. C’est noir. C’est le silence sourd. C’est l’oppression d’être toute petite dans un hangar en plein nuit au milieu de rien, d’une vie absente. Je m’auto-encourage : juste le souvenir d’un grillon, d’un insecte… rien ne vient. Je suis seule au milieu de rien, au milieu du rien.
Seule.
Il n’y a plus que la sensation de la larme. Je connais la suite. J’entends le tic-tac du réveil. Je supplie mon cerveau de me déconnecter du réel. Je hais le tic-tac. Le présent revient à moi. Je ne suis plus dans mon ailleurs. Figée. Chaque muscle de mon corps contracté dans la tension de l’agression à venir. Je le sais et j’appréhende. Mon corps se tend, se tord entier. L’estomac se noue. Je crois que toutes mes viscères sont des serpillières qu’on essore.
Je suis dans le lit de mes parents. J’ai 15 ans. La lumière aveuglante est déjà là sous mes paupières. J’ai dormi trop longtemps. Fait chier.
Pourquoi suis-je là ? J’aimerais l’oublier. J’ai envie de vous dire que c’est exceptionnel, une fois et c’est fini. Mais dormir là, c’est une routine : Ma mère travaille de nuit et enchaine une mission de jour. Elle est infirmière. Elle ne vit que, par et pour son boulot. Avoir de l’argent l’obsède. Elle bosse tout le temps. Je suis récompensée de son absence. J’ai le droit de dormir avec mon père. J’ai 15 ans… J’insiste. Je ne suis pas toute petite, âgée de 3 ans et terrorisée par un cauchemar. Je n’ai pas le choix. C’est un cadeau. Il me faut contacter de la joie interne du souvenir de : moi léchant le plat de l’appareil du gâteau au chocolat que mon pépé Erwin a fait pour moi… parce que le gâteau pas encore cuit, qu’est-ce que c’est… bon… Et là, je peux faire « comme si » je suis heureuse de ce cadeau paternel qui en vrai me dégoute d’avance. Et dont je connais toute la partition, toutes les variations. Je ne peux pas montrer un refus. Je dois sourire et avoir l’air crédible. Je n’ai pas envie d’un coup de poing dans le ventre. Alors je sollicite intensément ce souvenir de gâteau, de pâte à gâteau. Je souris. C’est le bal des illusions !
Comme toutes ces nuits de récompense, je suis au lit avec lui. Il m’a prise dans ses bras pour s’endormir, m’endormir. On est en chien de fusil. Je suis obligée de dormir en t-shirt et sans culotte. Comprenez : « c’est pour que ça respire ». Lui dort en caleçon, torse nu. Je n’aime pas les calbuts ! Ça me donne la gerbe. On ressent tout ce qui est dedans. Ça pendouille, c’est dégueulasse.
Si je m’arrêtais là, vous diriez que c’est déjà un franchissement des limites. Qu’est ce que j’aimerais que cela s’arrête là ! « Coupez ! Scène suivante ?! » Non ! C’est une routine. C’est toutes les semaines. Ça ne s’arrête qu’à sa mort.
Ce soir-là, comme tous les soirs, je suis étouffée par son corps de plus de 100 kilos qui me tient comme une poupée de chiffon. Je bénis sa fatigue et son départ dans les limbes rapide.
Ce n’est pas pour tout de suite.
Moi je reste éveillée, attendant dans cette hypervigilance chronique qui est toujours mienne. Je respire le plus lentement possible. Je sais que si mon rythme s’accélère, il va se réveiller. Et hop, j’aurai double peine. Et me voilà, sombrant dans le sommeil malgré mon envie de lutter. Il est surement 3 ou 4h matin. Je n’aurais pas dû résister autant. Je vais le payer cher. Et pourtant, ne pas résister autant, c’est le risque d’être réveillée par un corps m’étouffant de tout son poids sans l’avoir anticipé.
C’est le matin. Je garde les yeux fermés. Je veux faire durer la fuite onirique dont je n’ai aucun souvenir. Je repense au temps passé. Je vous l’ai déjà dit plus haut. Je sens dans la pupille de mes yeux la chaleur de la lumière d’un dimanche matin qui est déjà bien réveillé. Je sais que j’ai dormi trop longtemps. Il est surement 10h. Si je m’étais réveillée plus tôt, j’aurais pu fuir discrètement le lit. J’aurais pu faire la petite souris. Celle qui regarde la TV. J’aurais déplacé la scène dans le salon. Mais parfois ça marche. Mais j’étais trop fatiguée. Le tic-tac m’obsède. J’ouvre les yeux, doucement. Ne pas être éblouie. Il fait si chaud. Je sors un pied du lit. Je suis du côté de ma mère. Elle dort près de la porte. Je tente le coup ? Je ne regarde pas à ma gauche. Je suis couchée sur le dos. Le mouvement se diffuse dans cette double couette. Zut. Il bouge. Je le vois dans ma vision périphérique. Merde, fait chier. Son dos poilu. Son crâne. Je vois tout de son épaule découverte. Je la trouve répugnante. Je suspends mon mouvement. Il tressaille. J’arrête presque de respirer. Si j’étais dehors, fuir d’un agresseur inconnu serait la solution. Mais ici, disparaître de l’instant présent, c’est ma seule fuite. Je tente d’attendre qu’il soit techniquement trop tard car « maman va rentrer ». « Faites que son sommeil dure jusqu’à 14h » est la supplique que je répète, que je marmonne en silence sur mes lèvres. Je n’aurais que la douche à subir à cette heure-là. Je fais des plans, des hypothèses sur les possibles qui se présentent à moi.
Merde. Il est réveillé. Il se tourne comme un ours. Il a un sourire jusqu’aux oreilles. Un sourire plein d’un amour romantique. Un sourire qui n’a pas sa place ici. Il repère que je suis réveillée. J’ai oublié de fermer mes yeux. Merde, quelle conne je suis ! Il me dit « viens près de moi ». Je fais celle qui feint de ne pas avoir entendu, d’être en demi-réveil. « Viens dans mes bras » son ton est ferme, aucune négociation. C’est dit avec un amour si doux, si romantique, si tendre, non, c’est dit sans choix. Si je suis réticente, je vais prendre cher, encore plus. Puis son sourire amoureux revient. Ça tranche avec l’horreur de nos rôles : moi la fille, lui le père. Je n’ai pas le choix. Et me voici en chien de fusil, encore. Il est là avec son caleçon de merde qui ne laisse aucun doute sur son érection. Sa main glisse lentement sous mon t-shirt. Il caresse mon ventre. Je regarde l’heure. 10h14. Dans cette position , j’ai une vue imprenable sur le réveil de ma mère. Elle a un radio réveil. Il est classique, noir avec chiffres en rouge. Pourquoi rouge et noir ? Je suis là, à me questionner encore sur le rouge et noir pour ne pas questionner le réel. Il est dur son sexe. Il presse de sa main mon bassin vers lui. Il hésite encore : aller vers mes seins ou mon sexe. Si c’est mon sexe. Je vais prendre dans le cul, si c’est mes seins, je vais prendre dans mon vagin. La dernière fois, j’ai chié, il ira vers les seins.
Pourquoi vous épargner la réalité de ces gestes. Elle existe. Oui, c’est vomitif à lire. Et pourtant… ce n’est qu’un moment. Il y a encore de l’air après. Encore de la vie, amoindrie certes mais présente.
Il part vers le haut. Je respire le plus lentement possible. Vous savez cette respiration sous contrôle quand on essaie de traverser un examen médical douloureux. Je respire. Et je me le dis en boucle « respire ». Sa main touche mon sein gauche. Il le caresse, le presse. Il joue avec mon téton. Purin, je déteste ça. Ça me crispe dans toute ma colonne vertébrale. Je crisse intérieur et j’ai un mouvement de recul au niveau ma ceinture scapulaire vers l’arrière, les muscles de ma gorge se contractent, ma mâchoire serré., j’ai le sentiment que mon coccyx se recroqueville. Je sers les fesses. Il en profite. Va et vient doux, léger. Il se branle doucement, tâte mon sein. Bon, c’est parti pour le vagin. Il faut que je prenne du plaisir, il faut que je mouille. Il le faut. Je suis dans une envie de mouiller très intellectuelle. Je le veux parce qu’il le faut, il le faut pour moi. Il le faut parce que sinon j’ai mal, il se plaindra. Il me fera encore plus mal. Alors je réponds au va et vient pour activer la mécanique qui fait que sa façon de fracturer mon sexe sera moins douloureuse pour moi. Je cherche la mécanique lubrifiante.
Il me faut ne pas avoir trop mal et qu’il puisse rentrer sans que cela soit sec. Une pensée obsédante. Je me dis « Allez Anne, allez… arrête de faire de la résistance, pense à céder ». Je suis la vague des va-et-vient. Je contracte et relâche mon périnée, espérant que ça motive mon clitoris. Allez faut que ça mouille… faut que ça mouille, merde. Ça vient… je ne suis plus qu’un corps, une mécanique. Je suis « trempée » comme il le faut.
« Arrête de m’exciter. Tu es malsaine » lance-t-il. La ronde des phrases va commencer. Litanies qui le déchainent. Je suis perverse, il va le lâcher. Je le pervertis. Sûrement. J’ai quand même cherché à mouiller pour traverser la douleur. Il se sert de ça contre moi. Un preuve de mon vice et non de ses sévices. Il me retourne en appuyant sur mon épaule gauche, sa main quittant mon sein, repassant au-dessus de mon t-shirt. Je suis à plat. C’est le milieu du lit. Entre le matelas du coté de ma mère et celui de mon père, il y a une espèce de latte en bois. Je déteste ça. J’ai cette barre dans le dos. Aplatie comme une crête. J’ai mal. Je sens la douleur qui va monter. Il ne va pas me déplacer. Il s’en fout. Il m’a mise à plat. Je sers les jambes. Droite comme un I. D’un petit mouvement de sa jambe droite, celle qui est sur le haut du flan de son corps gras., il écarte un peu mes jambes. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche, comme des petits mouvements de balayette pour épousseter le manque d’espace. Il est toujours sur le coté et moi à plat. « Tu es vicieuse quand même ».
J’ai mal aux épaules. Pourtant, il est encore à côté de moi. Mais je sais ce que son corps sur moi va me faire ressentir. Il retire son caleçon. Ce n’est pas systématique d’ailleurs. Il lui arrive souvent de juste sortir son sexe. Il est au-dessus de moi. Il s’insinue entre mes jambes. Il les écarte avec tout le poids de son corps. J’ai l’impression d’être une grenouille crevée sur le lit, jambes écartées. J’ai son poids qui commence à se faire sentir sur mon bassin. Il va, il vient, encore et encore. « Tu m’obliges à faire ça. T’es qu’une perverse. Salope ». Et il va, et il vient, et il va et il vient. Et je sens la lame de bois dans mon dos. J’ai son corps qui se fait présent… 100 kilos qui m’écrasent. Il lâche l’appui sur ses bras. Il m’écrase de tout son corps et ce n’est plus que son bassin qui va et vient. Il est qu’un connard de malade fatigué. Le diabète ça n’aide pas mais sa perversion si. Il bande et ça fait chier. Sa tête se calle dans le creux de mon cou à droite. Ma tête glisse vers le côté. J’ai le regard qui regarde la fenêtre. Il y a un beau ciel bleu. C’est beau. Je ne ressens que lointainement mon corps.
Il est beau ce ciel.
Et si j’allais faire un tour à vélo cet après-midi ? Il doit faire chaud. Où sont mes lunettes de soleil ? Je me perds. La mécanique dissociative est là… je suis perdue dans le ciel bleu. Un corbeau ou une corneille passe dans mon champs visuel. Je ne suis pas douée en volatiles. Qu’est-ce que c’est ? Peu importe. Je me souviens que les oiseaux ont une bonne vue. Tic-tac, avant, arrière. Des litanies d’insultes, des litanies de prétexteS disant que je le pervertiS en l’obligeant à faire ça.
AppelLE un chat un chat? connard. Son mouvement ne fait plus que tic-tac. Je suis perdue dans l’observation de cet oiseau qui passe et repasse… je voyage jusqu’à lui, comme si je volais au-dessus de mon corps, je m’éloigne de la chambre… je m’envole dans cette diagonalE que prend mon regard vers le volatile. Je me perds dans son observation. Il tournoie… ma conscience se demande comment est le monde vu de là-haut.
Me voit-il ? A force de me demander, je finis par imaginer ce que c’est que d’être cet oiseau. Je me vois. Mon regard se détourne. Je regarde le monde vu d’en haut. Je regarde le rond-point devant notre immeuble. Un bus qui passe. Je vole sur le chemin vers mon école. J’imagine ce trajet vu du dessus. Je passe au-dessus du petit pont, j’avance, les arbres vus dessus. Je bifurque dans un quartier avec des maisons privatives. Je slalome. C’est agréable. Je plane. J’arrive au niveau de mon lycée. Je plane au-dessus du gymnase, de la cours, des bâtiments.
Il a fini. Je suis violement reprise à mon corps. J’ai mal. Il se repose sur mon corps. Il est à bout de souffle. Il roule vers son coté du lit. Je sens son sperme couler de ma vulve. J’ai mal au dos. Il reprend encore son souffle.
Le temps s’étire. Je regarde le plafond. J’ai le souffle court. Il y a le fantôme de son poids sur moi. Il dit « à la douche » en brisant le silence. Ma tête glisse sur la droite. 10h19. Je soupire intérieurement. Mais si je le montre, il va surement me frapper. La douche à deux, c’est obligatoire. Même quand ma mère est là. Il parait que c’est normal. J’ai mal aux jambes. Elles restent coincées dans cette position de grenouille écrasée. Je ne laisse pas couler la moindre larme. Je ne laisse pas sortir la moindre protestation. Il faut reprendre la vie normale. C’est normal chez nous de toute façon.
Il fait chaud. J’irai faire du vélo cet après-midi, il dira oui. Ça justifiera que je marche mal. Et si je mourais sous une voiture ? Durant la douche où il me frotte, il me demande de laver mon vagin avec de l’eau direct dedans via la pomme de douche. Je déteste ça. J’ai la chatte qui va me gratter au-dedans, encore.
J’ai le corps fracturé. Je me sens fracturée, morcelée, en morceau, bout de moi décharné. Mais surtout, ne rien montrer, car il va me fracasser sinon.
J’ai toujours mal aux épaules dans les relations sexuelles. Ce qu’il a fait dans ces viols à répétition sont des gestes classiques, communs dans la sexualité… que rien n’est simple, ni le chien de fusil, ni le missionnaire. Ni rien. Parce qu’il a exploré beaucoup de sa sexualité sur moi. C’est un viol. Ne l’oubliez jamais. Brutal.